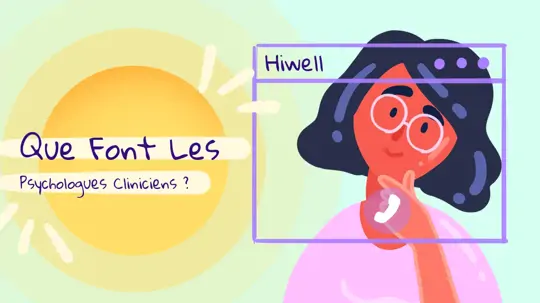Commencez à vous sentir mieux dès aujourd’hui !
Connectez-vous avec votre psychologue dès aujourd’hui et prenez le contrôle de votre vie comme nos 850 000 patients satisfaits.
CommencerLes êtres humains cherchent naturellement à éviter la mort. Ils tentent de ne pas envisager leur propre disparition ni celle de leurs proches. Oublier la mort peut aider à vivre pleinement, car y penser constamment serait insoutenable. Il existe toutefois une différence subtile entre l’oubli et le déni de la mort.
Oublier la mort permet d’avancer, tandis que la nier totalement complique le sens que l’on donne à la vie. En psychologie existentielle, la relation que nous entretenons avec la mort est perçue comme un équilibre complexe. Certains disent que les personnes en fin de vie ont avant tout besoin de rire. Beaucoup souhaitent vivre dans une société où la mort est évoquée avec franchise.
Le déni intervient souvent chez celles et ceux qui pensent ne jamais vieillir, qui privilégient l’apparence ou la réussite. Pourtant, lorsque la mort nous touche, même si on a tenté de l’ignorer, le deuil s’impose comme une réalité brutale.
Le deuil est cette douleur profonde ressentie après la perte d’un être cher. Il se manifeste par un choc initial, suivi d’émotions comme la tristesse ou la colère. Des signes physiques peuvent apparaître, tels que des troubles du sommeil, des variations de l’appétit ou une sensation d’oppression. Des symptômes psychologiques comme le refus de la réalité ou le retrait social sont également fréquents.
Quelle est la différence entre deuil et deuil traumatique ?
Le deuil est une réponse naturelle et saine à la perte. Sa durée varie généralement de six mois à un an, selon la relation avec la personne disparue et les circonstances du décès. D’après le modèle de Kübler-Ross, le processus de deuil comporte cinq étapes 1 :
- Le choc et le déni
- La colère
- La négociation
- La dépression
- L’acceptation
Le deuil traumatique diffère par son intensité et son origine. Il survient après une perte soudaine, inattendue ou violente. Il peut aussi apparaître lorsque la personne interprète la perte comme particulièrement brutale. Ce type de deuil présente des symptômes proches de ceux du trouble de stress post-traumatique.
Comment un deuil peut-il devenir traumatique ?
Comme dans beaucoup de cas psychologiques, les expériences vécues durant l’enfance et leur impact sur l’équilibre mental jouent un rôle important dans l’apparition du deuil traumatique.
La dépendance affective, la réciprocité dans la relation ou le sentiment de responsabilité envers la personne disparue figurent parmi les déclencheurs. La perception d’une mort brutale, même si elle ne l’est pas objectivement, peut suffire à provoquer un traumatisme.

En 1999, une étude a permis d’identifier deux ensembles de critères diagnostiques pour le deuil traumatique 2.
Critère A
Ce critère concerne la perte d’un proche et les symptômes liés à l’angoisse de séparation. Le décès est souvent soudain et ressenti comme brutal. Il n’est pas nécessaire que la relation ait été très intime, mais elle doit avoir impliqué confiance, attachement ou identification forte.
La personne endeuillée traverse des épisodes répétitifs de souffrance, de recherche du défunt, de manque, de nostalgie douloureuse. L’angoisse de séparation devient alors persistante et perturbante, affectant le fonctionnement quotidien.
Critère B
Ce critère rassemble les manifestations émotionnelles et cognitives du traumatisme. On distingue 14 symptômes caractéristiques :
- Incapacité à se projeter dans l’avenir
- Engourdissement émotionnel
- Sensation de détachement
- Vide intérieur
- État de choc prolongé
- Paralysie émotionnelle
- Difficulté à accepter la réalité de la mort
- Sensation que la vie n’a plus de sens
- Refus de croire qu’une vie sans la personne disparue est possible
- Impression qu’une partie de soi a disparu
- Sentiment que le monde s’effondre
- Perte de sécurité intérieure
- Croyances erronées sur une éventuelle responsabilité dans le décès
- Douleur, colère et inconfort extrêmes face à la perte
Pour poser un diagnostic, au moins quatre de ces symptômes doivent être présents, durer plus de deux mois et perturber significativement la vie sociale, professionnelle ou personnelle.
Le traitement du deuil traumatique
Le traitement varie selon les besoins de la personne et les troubles associés identifiés lors de l’évaluation clinique. Celle-ci permet de choisir l’approche thérapeutique ou, si besoin, un traitement médicamenteux 3.
Selon certains courants, le deuil ne nécessite pas toujours de prise en charge car il suit un processus naturel. Toutefois, en cas de deuil traumatique, les symptômes sont souvent si intenses que l’accompagnement thérapeutique s’impose 4.
Le deuil touche également le système familial. Lorsqu’un proche consulte, il est souvent bénéfique d’informer ou de soutenir les autres membres de la famille pour les aider à traverser eux aussi cette période difficile.
Conseils pour traverser un deuil de manière saine

- Passer du temps avec des personnes bienveillantes
- Parler de ses émotions à une personne de confiance
- Prendre soin de sa santé mentale et physique : sommeil, alimentation, rythme
- Éviter les comportements de fuite comme la consommation d’alcool ou de drogues
- Ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé mentale
Il est également recommandé d’éviter de prendre des décisions majeures tant que le processus de deuil n’est pas arrivé à maturité. Emménager ailleurs, démarrer une nouvelle relation ou avoir un enfant trop tôt peut freiner l’acceptation de la perte.
Sources
- Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. Simon and Schuster.
- Jacobs, S. C. (1999). Traumatic Grief: Diagnosis, Treatment, Prevention. Bruner-Mazel.
- Sezgin, U., Yüksel, S., Topçu, Z., & Dişcigil, A. G. (2004). When is traumatic grief diagnosed? When does treatment begin? Journal of Clinical Psychiatry, 7(3), 167-175.
- Prigerson, H. G. et al. (1995). Inventory of Complicated Grief: a scale to measure maladaptive symptoms of loss. Psychiatry Research, 59(1-2), 65-79.
- Harvard Mental Health Letter (2011). Coping with complicated grief.