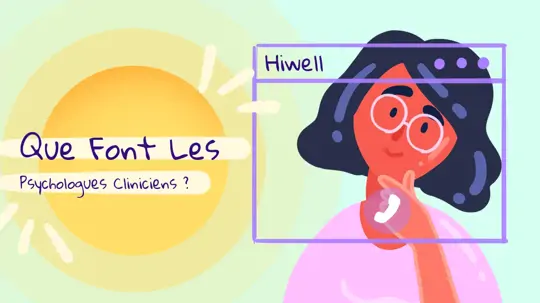Commencez à vous sentir mieux dès aujourd’hui !
Connectez-vous avec votre psychologue dès aujourd’hui et prenez le contrôle de votre vie comme nos 850 000 patients satisfaits.
CommencerNature et Humain
La vie humaine entretient un lien étroit et indissociable avec la nature. Une simple promenade en forêt ou un moment de calme au bord de l’eau suffit à rappeler combien l’environnement soutient notre équilibre mental et physique. Ce lien dépasse la simple coexistence : nature et humanité s’influencent mutuellement, continuellement. Ainsi, toute transformation de l’un se répercute sur l’autre, parfois de manière visible, parfois plus insidieusement. Cette interdépendance est au cœur des tensions émotionnelles provoquées par les crises écologiques actuelles.
Aujourd’hui, la crise climatique mondiale est une réalité incontestable. Ses effets ne se limitent pas aux écosystèmes ou aux chiffres alarmants des rapports scientifiques. En tant qu’êtres humains, nous en ressentons déjà les conséquences, à la fois dans notre corps et dans notre esprit. Biologiquement, psychologiquement, émotionnellement, nous sommes affectés à des degrés divers. Et tout indique que cette influence continuera de s’intensifier dans les années à venir.
Le changement climatique a, de manière directe et indirecte, un impact croissant sur notre santé mentale. Il est inévitable que les bouleversements environnementaux nourrissent des troubles émotionnels, parfois profonds. Dans ce contexte, ressentir de l’anxiété, de la tristesse, de l’inquiétude ou un sentiment d’impuissance est une réaction humaine normale. Il arrive même que ces émotions deviennent difficiles à gérer au quotidien, tant elles reflètent une perte de repères face à un avenir incertain.
Afin de mieux comprendre les effets psychologiques de la crise climatique, de nouveaux concepts ont fait leur apparition dans notre littérature. À mesure que différentes disciplines et points de vue se croisent, une vision plus riche de l’impact environnemental sur l’esprit humain se dessine. L’un des termes désormais incontournables est celui de éco-anxiété, qui fait l’objet de cet article 1.
Écologie et anxiété
Dans son sens le plus large, l’anxiété est un état d’inquiétude profonde, nourri par la crainte d’une menace future. Elle naît souvent de l’imprévisibilité de ce qui vient, de l’anticipation d’un danger ou d’une souffrance possible, sans certitude qu’ils se réalisent. L’écologie, en tant que science naturelle, se concentre quant à elle sur les interactions entre tous les êtres vivants de la planète, ainsi que leurs liens avec l’environnement qui les entoure.
Le terme « éco-anxiété » est issu de la combinaison des mots « anxiété », largement étudié en psychologie, et « écologie ». On parle aussi d’anxiété environnementale, ou encore d’anxiété liée au changement climatique. Toutes ces expressions renvoient à une même réalité : la détresse émotionnelle provoquée par la dégradation de l’environnement et les incertitudes qu’elle génère pour l’avenir.
Qu'est-ce que l'éco-anxiété (anxiété environnementale) ?
L’éco-anxiété a été définie par l’American Psychological Association (APA) comme « une peur permanente d’une apocalypse environnementale »2. Autrement dit, une personne qui en souffre est constamment préoccupée par l’état de la planète et l’avenir du monde, en raison des catastrophes écologiques actuelles ou à venir.
Ce concept est étroitement lié à la perspective de désastres environnementaux et à la crise climatique, désormais au cœur des préoccupations mondiales. Selon cette approche, l’éco-anxiété désigne une forme d’angoisse intense face à l’incertitude quant à la survie des espèces vivantes sur Terre, fondée à la fois sur des données scientifiques concrètes et sur la possibilité de catastrophes futures1.
Symptômes de l'éco-anxiété
Comment reconnaître l’éco-anxiété ? Être sensible aux questions environnementales ne signifie pas nécessairement en souffrir, mais certains signes peuvent alerter. Les symptômes de l’éco-anxiété ressemblent à ceux de l’anxiété générale, à ceci près que les pensées et les inquiétudes sont centrées sur l’environnement. Voici les manifestations les plus fréquentes :
- Sentiment d’impuissance face à la crise climatique
- Peur intense ou anxiété persistante liée aux problématiques environnementales
- Difficulté à se concentrer
- Insomnie et fatigue chronique
- Colère ou frustration envers les dirigeants perçus comme inactifs
- Pensées obsessionnelles autour du futur de la planète

L'éco-anxiété est-elle un trouble ?
L’éco-anxiété n’est pas considérée comme un « trouble » au sens clinique, car elle constitue une réaction naturelle et compréhensible face à un monde en mutation. Il s’agit d’une réponse émotionnelle à une réalité bien tangible. Toutefois, chez certaines personnes, cette anxiété peut devenir envahissante, au point d’interférer avec la vie quotidienne. En s’intensifiant, elle risque de favoriser l’apparition d’autres troubles psychiques.
Les personnes concernées par l’éco-anxiété sont souvent habitées par une inquiétude constante, non seulement pour leur propre avenir, mais aussi pour celui des générations futures. Cette peur du devenir du monde peut parfois être si forte qu’elle conduit certains à remettre en question des décisions majeures, comme celle d’avoir des enfants 2.
À cette angoisse latente s’ajoutent souvent d’autres émotions pesantes, comme un sentiment d’impuissance, de tristesse, de colère ou de désespoir. Au-delà des conséquences physiques du changement climatique, ses effets émotionnels prolongés peuvent aussi engendrer des troubles tels que la dépression ou les crises d’angoisse 3.
Qui souffre d'éco-anxiété ?
Tout individu sensible aux questions environnementales peut être touché par l’éco-anxiété. Toutefois, certains groupes sont plus vulnérables que d’autres, en raison de leurs conditions de vie, de leur exposition directe aux effets du changement climatique ou de leur situation psychologique. Voici les principaux groupes à risque :
- Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
- Habitants des régions arides ou exposées aux catastrophes naturelles
- Professionnels intervenant sur le terrain lors de crises environnementales
- Personnes atteintes de troubles anxieux ou dépressifs
- Groupes à faibles revenus
- Jeunes enfants, adolescents et personnes âgées

Éco-anxiété chez l'enfant et l'adolescent
Des études montrent que l’éco-anxiété est de plus en plus répandue, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. Cette génération, qui vivra le plus longtemps avec les conséquences du changement climatique, sera aussi la plus exposée à ses effets potentiellement néfastes. Il n’est donc pas surprenant que ces jeunes soient particulièrement préoccupés par l’avenir.
Dans ce contexte, certaines approches peuvent aider les adultes à accompagner leurs enfants face à ces inquiétudes. Leur expliquer la situation avec des mots adaptés, les encourager à exprimer leurs émotions à travers le jeu ou le dessin, les protéger d’informations anxiogènes ou confuses issues des médias, et leur offrir plus de temps en pleine nature sont autant de gestes qui peuvent apaiser leur ressenti 4. Mais au-delà de cela, une question demeure : que pouvons-nous faire, concrètement, pour faire face à l’éco-anxiété ?
Comment faire face à l'éco-anxiété
L’éco-anxiété est de plus en plus fréquente, notamment dans des contextes qui menacent directement la nature et la survie humaine, comme la crise climatique ou la pandémie de COVID-19 1.
Dans notre pays, peu d’études ont encore été menées sur ce sujet. Pourtant, les catastrophes environnementales et leurs conséquences possibles peuvent générer une anxiété intense. Lorsque cette anxiété s’accompagne d’émotions fortes, elle peut perturber le quotidien et altérer la qualité de vie. Que peut-on faire, alors, pour atténuer l’éco-anxiété ? Voici quelques pistes pour y faire face :
- Consulter uniquement des sources d’information fiables concernant la crise climatique et les catastrophes écologiques. Éviter les fausses nouvelles et les contenus alarmistes.
- Éviter de suivre, sur les réseaux sociaux, des comptes qui diffusent régulièrement des scénarios catastrophes.
- Être attentif à ses pensées et à ses émotions face à ces sujets, et leur accorder une place sans jugement.
- Échanger avec des personnes partageant les mêmes préoccupations, créer du lien, chercher un soutien social.
- Passer à l’action, même à petite échelle. Les gestes individuels comptent et peuvent redonner un sentiment de maîtrise.
Comme évoqué plus haut, l’éco-anxiété n’est pas une pathologie, mais une réaction humaine face à des menaces réelles pesant sur notre avenir. Elle reflète notre lien profond avec le monde vivant. Il est donc naturel que toute menace pesant sur la planète ait un impact physique et psychologique sur ceux qui y vivent.
Dans ce contexte, ce qui importe, c’est de chercher des moyens d’équilibrer nos émotions, de faire de la place à ce que nous ressentons, de ne pas craindre de demander du soutien, et de rester conscients de ce que nous pouvons faire à notre échelle pour contribuer à un monde plus vivable.
Sources
- Kara, Y., 2022, Crise écologique et anxiété : l'éco-anxiété comme nouveau concept, Institut de la revue des sciences sociales de l’Université Dokuz Eylul.
- Aras, B. B. & Demirci, K., 2020, Effets psychologiques du changement climatique sur la santé humaine, article de synthèse.
- Cankardaş, S. & Sofuoğlu, Z., 2021, Revue du changement climatique et de ses effets sur l’individu, Nesne Journal of Psychology.
- Mayavakfi.org